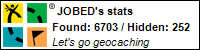jeudi 5 novembre 2009
Pensée du jour
Je me couche tellement tard et me lève tellement tôt que je me rencontre dans l'escalier.
mercredi 4 novembre 2009
FRUSTRATION : La grippe code postal A(H1N1)

Après nous avoir mis en garde contre une éventuelle pandémie de la grippe A(H1N1) et de nous avoir fait comprendre que l’heure était grave, pour ne pas dire nous avoir fait peur.
Voilà que les gens à présent veulent le vaccin, font des lignes 4 à 5 heures avant l’ouverture des centres de vaccination et c’est compréhensible on leur a fait tellement peur que c’est tout à fait normal qu’ils le veulent le vaccin tout de suite mais voilà que l’on les traite d’indisciplinés maintenant et qu’ils devraient faire preuve de civisme. (Civisme?)
Nous voici maintenant avec la loto vaccin, as-tu ton ticket?
Voici certaines choses que je ne comprends pas :
D’abord pourquoi ne pas avoir mobilisé des ressources imposantes c’est sérieux ou non cette cochonnerie de grippe? Un mort c’est un mort de trop qu’on nous répète à tous les événements tragiques. Bien ici à ce qu’on nous rapporte, on parle de la possibilité de milliers de morts. (En tout cas au Québec on a acheté des sacs et réservé des endroits où mettre les corps)
Pourquoi seulement un nombre limité de compagnie pharmaceutique peuvent produire le vaccin ? Pourquoi pas un vaccin générique ? La situation est grave ou non? C’est sûr que l’argent n’a rien à voir avec ça, cela doit être le délire de la grippe qui me fait penser ça.
Pourquoi, pas de vaccination les fins de semaine? On parle de la possibilité d’un grand nombre de décès ici, mais non on ne travaille pas les week-ends. À moins que le gouvernement interdira dorénavant aux gens de mourir le samedi et le dimanche, à vrai dire pas sûr que je serais surpris.
Les séances de vaccination ne débutent qu’en après-midi et aujourd’hui à Saint-Jean-sur-Richelieu, il n’y en a même pas, puis on devrait vous croire quand vous nous dîtes que c’est important de se faire vacciner. Qu’on ne rit pas avec la grippe cochonne.
Vous voulez recevoir le vaccin plus rapidement faites-vous arrêter, les détenus sont vaccinés avant les gens honnêtes. (Cé-ti pas beau ça) On se déplace pour les vacciner mais nos gens âgés dans les foyers doivent quémander et seulement peut-être iront-ils les vacciner.
Quand le Sinistre de la santé nous dit que le gouverne et ment a la situation en main, permettez-moi alors d’avoir très peur et ce n’est pas de la grippe dont j’ai peur.
Existe-t-il un vaccin contre le gouvernement?
L’ours, le lion et le cochon
Un ours, un lion et un cochon se rencontrent:
L'ours dit:
«Si je grogne dans la forêt, tous les autres animaux tremblent de peur.»
Le lion dit:
«Si je rugis dans la jungle, tous les animaux s'enfuient de peur.»
Le cochon dit:
« Moi, je tousse une seule fois et la planète entière se fait vacciner.»
L'ours dit:
«Si je grogne dans la forêt, tous les autres animaux tremblent de peur.»
Le lion dit:
«Si je rugis dans la jungle, tous les animaux s'enfuient de peur.»
Le cochon dit:
« Moi, je tousse une seule fois et la planète entière se fait vacciner.»
Ça vient d’où çà (9) : Y vente à écorner les bœufs !
Cette expression populaire signifie singulièrement qu'un vent souffle très très fort.
Depuis des années, on a pris pour acquis que cette expression visait à comparer l'intensité du vent à une force qui réussirait à arracher les cornes d'un bœuf.
Détrompez-vous !
Nos pionniers de la terre écornaient les boeufs seulement les jours de grands vents pour s'assurer que les guêpes (ou autres insectes) ne puissent pondre leurs œufs dans les plaies résultantes et ainsi causer de l'infection. De plus, le grand vent permettait à la plaie de sécher plus rapidement.
Une comparaison pas mal plus pratique et crédible, n'est-ce pas !
Depuis des années, on a pris pour acquis que cette expression visait à comparer l'intensité du vent à une force qui réussirait à arracher les cornes d'un bœuf.
Détrompez-vous !
Nos pionniers de la terre écornaient les boeufs seulement les jours de grands vents pour s'assurer que les guêpes (ou autres insectes) ne puissent pondre leurs œufs dans les plaies résultantes et ainsi causer de l'infection. De plus, le grand vent permettait à la plaie de sécher plus rapidement.
Une comparaison pas mal plus pratique et crédible, n'est-ce pas !
DÉFINITION : d’un anniversaire de mariage
Événement dont on peut se souvenir longtemps, si on l’oublie.
Pensée du jour
Les mini-jupes, c'est comme les sondages, ça donne des idées mais ça cache l'essentiel.
mardi 3 novembre 2009
PETIT BONHEUR : La roche pleureuse

Lorsqu’on traverse à L’Isle-aux-Coudres qui n’a pas pris le temps de s’arrêter pour aller voir la roche pleureuse au moins une fois.
Pourquoi une roche pleureuse ? D’où est sa provenance ?
La légende de la Roche pleureuse raconte que le printemps de 1806 avait été l'un des plus doux dont mémoire d'homme se souvînt. La glace ayant fondu plus vite qu'à l'accoutumée, la grande débâcle avait libéré le Saint-Laurent et permis la circulation des grands bateaux
Charles Desgagnés, un jeune navigateur allait se marier avec la belle Louise, mais il devait auparavant faire un voyage en Europe.
Ne t'en fais pas, ma Louise, murmura tendrement le jeune homme, je serai de retour pour l'automne et, avant que ne finisse l'été indien, nous serons mariés.
Sur ces paroles, une affreuse corneille crailla et s'envola d'une des branches de l'orme où elle était perchée. Quel mauvais présage ! Une corneille ! Cet oiseau maudit, compagnon du diable et ami des sorcières ! Louise pâlit. Charles tâcha de ne pas laisser percer son malaise. Mais une corneille qui croasse n'augure rien de bon !
Le jeune homme, pour conjurer le mauvais sort, prit la main de Louise et y mit un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il avait fait pour elle. Louise était contente ! Elle détacha le ruban rouge qui liait ses cheveux, l'enroula autour du bouquet qu'elle pendit à une branche du grand orme, au-dessus de la roche où elle était assise.
Sous ce bouquet, sous cet arbre, sur cette pierre, jura la belle Louise, je viendrai sans faillir guetter ton retour ! Ils s'embrassèrent alors sans entendre le claquement des ailes de la corneille, étouffé par le bruit des vagues qui s'échouaient sur la grève.
Tout l'été, Louise était allée s'asseoir sur sa roche, auprès de l'orme, sous le bouquet, à la pointe de l'île. Mais à présent que la date du retour approchait, elle y passait de longues heures, le regard comme vaguement suspendu aux ondes qui froissaient l'horizon. Le soir, à la brunante, elle rentrait à pas lents chez son père qui, pour l'aider à patienter, lui disait qu'il n'était pas rare que la mer sans vent retardât un peu le retour des grands voiliers, et il lui murmurait doucement ces consolations que savent les coeurs qui ont connu de grands chagrins.
Septembre arriva et Louise alla bientôt s'asseoir sur une pierre au bord du fleuve, sur la pointe de l'île, attendant patiemment son futur mari. Aucun trois mâts ne se présenta cependant à sa vue. Elle continua, de jours en jours, à attendre sur cette pierre, mais rien ne vint.
Quand les temps plus chauds revinrent, elle reprit place sur sa pierre, pleurant et se lamentant. Son chagrin grandissait de jours en jours. Si bien qu'à la fin mai, son père ne la revit plus. Ils ont été plusieurs à la chercher, ils ont cherché partout sur l'île. Après plusieurs jours de recherche, son père constata une pierre inhabituelle, qu'il n'avait jamais vu sur la pointe de l'île. C'était une pierre qui suintait, laissant couler dans un bassin des gouttes, des larmes sans fin. Cette pierre pleurait. Louise pleurera pour toujours son mari disparu.
Une autre version de la fin va comme suit :
Un beau soir de mai, un messager vint enfin apprendre à la vieille mère de Charles que son fils avait péri en mer. Louise, qui se trouvait alors auprès de la vieille femme, poussa un cri et sortit de la maison en courant.
Depuis lors, nul ne la revit plus. Son père se rendit à la pointe de l'île, où elle avait coutume de s'attarder. Anxieux, il suivit le faux-fuyant qui conduisait à la grosse roche tout à côté de l'orme. Il s'y assit. De sa voix forte il appelait sa fille :
Louise, Louise, où es-tu ? Louise, réponds à ton père !
Le silence, qui explique bien des choses, le silence expliquait au père de Louise qu'il ne reverrait jamais plus sa fille. Une fée en effet, touchée par le chagrin de la pauvre fille, l'avait changée en source, pour qu'à travers les flots, elle puisse, dans l'océan, retrouver et s'unir à son amant perdu en mer.
L'homme regarda le filet d'eau claire, cette petite source qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, surgir de la roche et se déverser en mer. Au-dessus de la roche, pendu à un ruban rouge, un frais bouquet de fleurs sauvages, bercé par la brise, lançait dans l'air mille parfums exotiques. Sur une branche de l'orme chantait maintenant un bel oiseau blanc.
Version 2009 :
Charles prit une croisière pour l’Europe y rencontra une « pitoune » à bord, s’envoya en l’air et mourut du SIDA. Pendant ce temps Louise tomba follement amoureuse d’un jeune garçon beau et riche, ils se marièrent et eurent un enfant puis vint le divorce et sur sa pension alimentaire la belle Louise pleura…..de joie., quel cœur de pierre.
Vive les vieilles légendes !
Ça vient d’où çà (8) : Le bonhomme sept heures
Il n'est pas nécessaire de remonter très loin dans le temps pour se rappeler que les parents avaient souvent recours au « bonhomme sept heures » pour encourager les enfants à se coucher tôt.
Personnage terrible selon les dires des parents, le bonhomme sept heures était tout aussi réel que le Père Noël. Pourtant, personne ne savait vraiment ce qui arrivait en sa présence, car la légende ne le disait pas.
Mais d'où vient cette idée de bonhomme sept heures? On pourrait penser que les enfants hantés par la perspective de sa visite devaient se coucher avant sept heures pour ne pas le voir apparaître. Il n'en est rien.
L'expression bonhomme sept heures serait une déformation du terme anglais bone setter. Le bone setter était en fait un « ramancheur », soit une personne qui replaçait les articulations démises ou qui faisait des manipulations pour guérir, par exemple, les maux de dos.
Lorsqu'on appelait le bone setter, la personne traitée criait souvent de douleur, ce qui faisait très peur aux enfants présents. Plus tard, lorsque ceux-ci ne voulaient pas obéir, on les menaçait de la visite du bone setter. Au Canada français, le bone setter est devenu le bonhomme sept heures.
Finalement, le bonhomme sept heures est sans l'ombre d'un doute l'ancêtre de nos chiropraticiens des temps modernes. Difficile d'imaginer d'envoyer nos petits au lit en les menaçant simplement d'une visite du chiro, n'est-ce pas!
Personnage terrible selon les dires des parents, le bonhomme sept heures était tout aussi réel que le Père Noël. Pourtant, personne ne savait vraiment ce qui arrivait en sa présence, car la légende ne le disait pas.
Mais d'où vient cette idée de bonhomme sept heures? On pourrait penser que les enfants hantés par la perspective de sa visite devaient se coucher avant sept heures pour ne pas le voir apparaître. Il n'en est rien.
L'expression bonhomme sept heures serait une déformation du terme anglais bone setter. Le bone setter était en fait un « ramancheur », soit une personne qui replaçait les articulations démises ou qui faisait des manipulations pour guérir, par exemple, les maux de dos.
Lorsqu'on appelait le bone setter, la personne traitée criait souvent de douleur, ce qui faisait très peur aux enfants présents. Plus tard, lorsque ceux-ci ne voulaient pas obéir, on les menaçait de la visite du bone setter. Au Canada français, le bone setter est devenu le bonhomme sept heures.
Finalement, le bonhomme sept heures est sans l'ombre d'un doute l'ancêtre de nos chiropraticiens des temps modernes. Difficile d'imaginer d'envoyer nos petits au lit en les menaçant simplement d'une visite du chiro, n'est-ce pas!
lundi 2 novembre 2009
FRUSTRATION : Tu n’es pas mieux que mort !

Lorsque je vois ou que j’entends dans les médias que des pierres tombales ont été renversées et endommagées dans un cimetière, ce que je donnerais pour mettre la main au collet sur ces crétins.
Quand tu ne peux respecter les morts, il n’y a certes pas grands choses dans la vie que ces vermines doivent respecter.
En poigner un sur le fait, qu’est ce que je ferais avec cette ordure?
Je confronterais ce minable à la famille et je lui demanderais de leur expliquer, pourquoi il s’en est pris à leur père, leur mère, leur enfant etc. à un être qui leur était cher quoi.
Tant qu’aux frais requis pour remettre le tout dans son état original, devinez qui en assumerait la facture, et pour terminer quand tout serait à la satisfaction de la famille, il serait en plus dans l’obligation d’aller y déposer une gerbe de fleurs.
Je crois que nous sommes faisons preuve de beaucoup trop de tolérances, envers ces gibiers de potence. Potence..tiens tiens quel beau mot et solution? pour ces fumiers.
Nous sommes rendus au point que les gens ont plus de respect pour l’autre truie que pour autrui
Ça vient d’où çà (7) : Être mis à pied
L'expression « être mis à pied » est très répandue depuis quelques siècles. Elle signifie simplement le renvoi temporaire ou permanent d'un employé suite à un manque de travail ou à une faute professionnelle.
L'origine et le sens propre de cette expression sont pourtant beaucoup plus près de la réalité que vous croyiez. Au temps de la cavalerie, quand un grenadier était pris en faute, il était privé de son cheval, sa monture, pendant plusieurs jours. Il devait donc se déplacer à pied. Cette mise à pied était la sanction habituelle, une sorte de dégradation provisoire, pour tous les fautifs de la cavalerie.
L'origine et le sens propre de cette expression sont pourtant beaucoup plus près de la réalité que vous croyiez. Au temps de la cavalerie, quand un grenadier était pris en faute, il était privé de son cheval, sa monture, pendant plusieurs jours. Il devait donc se déplacer à pied. Cette mise à pied était la sanction habituelle, une sorte de dégradation provisoire, pour tous les fautifs de la cavalerie.
Pensée du jour
Si tu tapes ta tête contre une cruche, et que ça sonne creux,
n'en déduit pas forcément que c'est la cruche qui est vide.
n'en déduit pas forcément que c'est la cruche qui est vide.
vendredi 30 octobre 2009
*****RELÂCHE*****
Encore une fois relâche me direz-vous,
Comme la visite débarque chez-nous.
Il risque d’y avoir un peu de remous
Mais lundi je serai au rendez-vous.
Comme la visite débarque chez-nous.
Il risque d’y avoir un peu de remous
Mais lundi je serai au rendez-vous.
PETIT BONHEUR : Changement d’heure

On change l’heure en fin de semaine dans la nuit de samedi à dimanche, vous me direz que l’heure change de seconde en seconde mais là, à 02h00 on gagnera 3,600 secondes d’un coup car il sera alors 01h00.
C’est qui le « smart » qui a pensé à ça de changer l’heure?
En avril 1784, Benjamin Franklin, oui celui que l’on connait, évoque pour la première fois la possibilité de décaler les horaires afin d'économiser l'énergie. (Déjà à cette époque là il y avait des écolos)
L'idée reste cependant sans suite et n’est reprise qu'à partir de 1907 par le Britannique William Willet qui démarre une campagne contre le gaspillage de la lumière. (Ça doit être pour ça qu’il y en a maintenant qui ne sont pas des lumières, par économie)
Avant 1884 et avant mon temps bien sûr, au Canada, on déterminait l'heure locale en faisant coïncider l'heure du midi avec le moment où le soleil atteignait son zénith. Puisque ce moment changeait d'est en ouest, l'heure locale variait considérablement d'une région à l'autre du pays.
Cette situation n'a causé aucun problème jusqu'au jour où le train a permis de voyager rapidement sur de longues distances. Il est alors devenu impossible de faire fonctionner les horaires des trains à partir d'une variété d'heures locales différentes. (Pourtant encore aujourd’hui c’est toujours impossible de faire fonctionner les horaires des trains) On a donc alors songé à établir des fuseaux horaires uniformes.
C'est donc à partir de 1884 que le Canada a été réparti en 7 fuseaux horaires et ce n’est qu’en 1973 que l'heure de Yukon s'unifia à celle du Pacifique, réduisant à 6 le nombre de fuseaux horaires et à 4h30 la différence d'est en ouest au Canada.
Mais comment a-t-on déterminé l'heure réglementaire au Québec? (On savait déjà à cette époque être différent pour se compliquer la vie)
En 1920, une loi visant à fixer une heure réglementaire fut adoptée au Québec. Elle officialisait ainsi la séparation du Québec quant aux fuseaux horaires. (On parlait déjà de séparation du Québec en 1920 ?)
C'est en 1924 que fut appliquée une loi québécoise concernant l'avance de l'heure. Ce sont les municipalités qui prenaient la décision quant à la période durant laquelle l'heure était avancée. Elles procédaient par référendum et le gouvernement pouvait, ou non, décider de donner suite à la demande des municipalités. (Pourquoi faire simple quand on peu foutre le bordel)
En 1928, une autre loi stipulait que l'heure avancée devait commencer le premier samedi de mai à minuit pour revenir à l'heure normale le dernier samedi de septembre à minuit.
En septembre 1929, il y avait une heure de différence entre Montréal et St-Jérôme pendant quelques semaines!
Évidemment, les communications n'étaient pas aussi fréquentes qu'aujourd'hui... Ça devait déranger un peu moins la vie sociale...
En 1942, c'est dans tout le Canada que fut adopté un décret instaurant l'heure avancée.
Maintenant essayez de me suivre, en 1953, les régions est de la partie ouest du Québec (on se souvient que le Québec avait été séparé sur la ligne du 68e degré) entretenaient des affaires surtout avec la Gaspésie et les Maritimes, alors qu'elles n'étaient pas sur le même fuseau horaire. Inconcevable!
On y remédia, le 23 octobre 1953, par un arrêté en conseil qui édicte que dans la partie du Québec située à l'ouest du 68e degré, mais comprise dans les "comtés" de Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Saguenay, l'heure réglementaire est en retard de 4 heures avec Greenwich. Autrement dit, une section de la partie ouest du Québec passait à l'heure de l'Atlantique. (De quoi en perdre son latin quoique le latin…)
Par contre, entre 1953 et 1961, les relations économiques des régions du Québec déclarées dans le paragraphe précédent, ayant pris plus d'importance avec l'ouest du Québec, on modifie alors l'heure réglementaire pour revenir à une différence de 5 heures avec Greenwich, le 25 octobre 1961. Il n'est cependant pas question d'avancer d'une heure durant l'été. (On n’a tu perdu du temps pour une question de temps)
Je vous fais grâce des détails quant aux autres manipulations politiques visant à établir l'heure réglementaire et les régions concernées durant ces années. Mais, c'est à partir du 12 mars 1963, que l'heure devenait avancée du dernier dimanche d'avril à 00h01 (minuit une minute) au dernier dimanche d'octobre à 00h01 pour les régions du Québec à l'ouest du fameux 68e degré de longitude.
Le 15 mars 1966, le moment de changer montres et horloges se fait à 2 heures du matin plutôt qu'à minuit et une minute à travers tout le Canada et les États-Unis. (Évidemment, on recule ou on avance les horloges à notre coucher, mais légalement ça se fait dans la nuit à 2h00.)
Pourquoi?
Pour éviter la confusion des jours (par exemple, dimanche 00h01 devenait samedi 00h01 et vice versa);
Les dates de naissance devenaient confuses;
L'âge de la majorité pouvait arriver 2 fois! (Une première fois avant le changement d'heure, une seconde après!)
L'expiration des assurances causait de la confusion lors de dommages.
Ça dérange moins les gens et moins de gens en pleine nuit.
En 1969, on change la ligne de séparation au Québec. Elle devient le 63e degré de longitude ouest (i.e. un peu à l'est de Havre St-Pierre, à travers l'île d'Anticosti et entre la Gaspésie et les îles de la Madeleine.) À l'ouest, l'heure normale est en retard de 5 heures avec Greenwich, alors qu'à l'est, elle accuse un retard de 4 heures.
Le changement d'heure est maintenant régi par les législations provinciales. Précédemment, c'était une législation fédérale.
Toutes les provinces changent l'heure, sauf la Saskatchewan qui a décidé de garder la même heure toute l'année et on se demande pourquoi c’est si compliqué de suivre les changements.
L’important donc dans la nuit de samedi à dimanche, perd pas tout ton temps, et gagne une heure de dodo supplémentaire.
Merci à mon Père et à ma Mère
Depuis la nuit des temps l'histoire des pères et des mères prospèrent
Sans sommaire et sans faire d'impairs, j'énumère pêle-mêle, Pères Mères
Il y a des pères détestables et des mères héroïques
Il a des pères exemplaires et des merdiques
Il y a les mères un peu père et les pères maman
Il y a les pères intérimaires et les permanent
Il y a les pères imaginaires et les pères fictions
Et puis les pères qui coopèrent à la perfection
Il y les pères sévères et les mercenaires
Les mères qui interdisent et les permissions
Y'a des pères nuls et des mères extra, or dix mères ne valent pas un père
Même si dix pères sans mère sont perdus c'est clair
Y'a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent
Oubliant les commères et les langues de vipère
Il y a les « re-mères » qui cherchent des repères
Refusant les pépères amorphes
Mais les pauvres se récupèrent les experts(ex-pères) du divorce
Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère
Les pères primaires, les perfides, les personnels qui ont le mal de mère
Ceux qui laissent les mères vexent et les perplexes
Moi mon père et ma mère sont carrément Hors-pairs
Et au milieu de ce récit
Je prends quelques secondes,je tempère
Pour dire à mon père et à ma mère merci
Il y une mère candide et un père aimable
Il y une mère rigide et imperméable
Il y a des pères absent et des mères usées
Il y a des mères présentes et des perfusés
Il y a des mères choyées et des mères aimées
Il y a des pères fuyants et des périmés
Il y a la mère intéressée et la mère ville
L'argent du père en péril face à la mercantile
Il y a les pensions alimentaires, les « pères crédit »
Des pères du week-end et des mercredi
Y'a des pères hyper-fort et des mères qui positivent
Ou les coups de blues qui perforent les mères sans pères-pectives
Mais si les persécutés, le père sait quitter
Et si la mère pleure c'est l'enfant qui perd
Mais si la mère tue l'amertume la magie s'éveille
Et au final qu'elle soit jeune ou vielle la mère veille (merveille)
Moi mon père et ma mère sont carrément Hors-pairs
Et au milieu de ce récit
Je prends quelques secondes, je tempère
Pour dire à mon père et à ma mère merci
Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes
Perpétuellement à la recherche d'un homme à perpète
Il y a la mère célibataire persuadé de n'être personne
Et qui attends que dans ses chimères que derrière la porte un père sonne
Il y a les mères soumises et les pères pulsions
Il y a les mères battues et les percussions
Il y a les mères en galère à cause des pervers, des perturbés
Alors il y a la mère qui s'casse si elle est perspicace
En revanche, si le père et la mère s'acoquine et vont se faire mettre si je peux me permettre
La tension est à dix milles ampères
Car quand le père est en mère et que la mère obtempère
C'est la hausse du mercure car le père percute et la mère permute
Le père tend sa perche et la mère se rit de cette performance, de ce perforant impertinent
Elles sont les péripéties du père dur face à l'effet mère (l'éphémère)
Moi mon père et ma mère sont carrément Hors-pairs
Et au milieu de ce récit
Je prends quelques secondes, je tempère
Pour dire à mon père et à ma mère merci
Sans sommaire et sans faire d'impairs, j'énumère pêle-mêle, Pères Mères
Il y a des pères détestables et des mères héroïques
Il a des pères exemplaires et des merdiques
Il y a les mères un peu père et les pères maman
Il y a les pères intérimaires et les permanent
Il y a les pères imaginaires et les pères fictions
Et puis les pères qui coopèrent à la perfection
Il y les pères sévères et les mercenaires
Les mères qui interdisent et les permissions
Y'a des pères nuls et des mères extra, or dix mères ne valent pas un père
Même si dix pères sans mère sont perdus c'est clair
Y'a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent
Oubliant les commères et les langues de vipère
Il y a les « re-mères » qui cherchent des repères
Refusant les pépères amorphes
Mais les pauvres se récupèrent les experts(ex-pères) du divorce
Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère
Les pères primaires, les perfides, les personnels qui ont le mal de mère
Ceux qui laissent les mères vexent et les perplexes
Moi mon père et ma mère sont carrément Hors-pairs
Et au milieu de ce récit
Je prends quelques secondes,je tempère
Pour dire à mon père et à ma mère merci
Il y une mère candide et un père aimable
Il y une mère rigide et imperméable
Il y a des pères absent et des mères usées
Il y a des mères présentes et des perfusés
Il y a des mères choyées et des mères aimées
Il y a des pères fuyants et des périmés
Il y a la mère intéressée et la mère ville
L'argent du père en péril face à la mercantile
Il y a les pensions alimentaires, les « pères crédit »
Des pères du week-end et des mercredi
Y'a des pères hyper-fort et des mères qui positivent
Ou les coups de blues qui perforent les mères sans pères-pectives
Mais si les persécutés, le père sait quitter
Et si la mère pleure c'est l'enfant qui perd
Mais si la mère tue l'amertume la magie s'éveille
Et au final qu'elle soit jeune ou vielle la mère veille (merveille)
Moi mon père et ma mère sont carrément Hors-pairs
Et au milieu de ce récit
Je prends quelques secondes, je tempère
Pour dire à mon père et à ma mère merci
Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes
Perpétuellement à la recherche d'un homme à perpète
Il y a la mère célibataire persuadé de n'être personne
Et qui attends que dans ses chimères que derrière la porte un père sonne
Il y a les mères soumises et les pères pulsions
Il y a les mères battues et les percussions
Il y a les mères en galère à cause des pervers, des perturbés
Alors il y a la mère qui s'casse si elle est perspicace
En revanche, si le père et la mère s'acoquine et vont se faire mettre si je peux me permettre
La tension est à dix milles ampères
Car quand le père est en mère et que la mère obtempère
C'est la hausse du mercure car le père percute et la mère permute
Le père tend sa perche et la mère se rit de cette performance, de ce perforant impertinent
Elles sont les péripéties du père dur face à l'effet mère (l'éphémère)
Moi mon père et ma mère sont carrément Hors-pairs
Et au milieu de ce récit
Je prends quelques secondes, je tempère
Pour dire à mon père et à ma mère merci
Ça vient d’où çà (6) : Attendre quelqu’un avec une brique et un fanal
Si vous vous êtes déjà fait attendre avec une brique et un fanal, c'est que l'on vous reprochait quelque chose et qu'on se préparait à vous servir une réprimande ou même une sanction. On peut comprendre pourquoi cette expression n'est pas de bon augure pour la personne en attente.
Mais encore une fois, l'origine de cette expression est très différente de la signification qu'elle a prise de nos jours.
Avant l'arrivée de l'automobile au début du 20e siècle et même plusieurs décennies après, durant l'hiver, nos ancêtres se déplaçaient au moyen de traîneaux tirés par des chevaux. On les appelait communément des « cotters ».
Naturellement, ces traîneaux n'étaient munis d’aucuns abris ou dispositifs pour réchauffer les passagers. Donc, des couvertures de laines et, à une certaine époque, de peaux étaient mises à leur disposition pour se couvrir pendant le voyage.
Quelques heures avant le départ, on s'assurait également de faire chauffer des briques près du poêle ou du foyer qui seraient ensuite placées au fond du traîneau pour garder les pieds des passagers bien au chaud.
Puisque les journées sont très courtes pendant l'hiver, le cocher ou conducteur attendait généralement les passagers avec des briques bien chaudes et un (ou des) fanal pour éclairer leur chemin s'il faisait nuit et ainsi se rendre à destination en toute sécurité.
Plusieurs se rappellent encore des cortèges lumineux de « cotters » qui défilaient pour se rendre à la messe de minuit.
Les opinions divergent quant à la raison pour laquelle cette expression a pris un sens différent au cours des années. Mais, il est facile de voir pourquoi l'image d'une personne qui en attend une autre, brique et fanal à la main a dû certainement influencer cette perception.
Chose certaine, des nos jours, vaut mieux éviter de se faire attendre avec une brique et un fanal.
Mais encore une fois, l'origine de cette expression est très différente de la signification qu'elle a prise de nos jours.
Avant l'arrivée de l'automobile au début du 20e siècle et même plusieurs décennies après, durant l'hiver, nos ancêtres se déplaçaient au moyen de traîneaux tirés par des chevaux. On les appelait communément des « cotters ».
Naturellement, ces traîneaux n'étaient munis d’aucuns abris ou dispositifs pour réchauffer les passagers. Donc, des couvertures de laines et, à une certaine époque, de peaux étaient mises à leur disposition pour se couvrir pendant le voyage.
Quelques heures avant le départ, on s'assurait également de faire chauffer des briques près du poêle ou du foyer qui seraient ensuite placées au fond du traîneau pour garder les pieds des passagers bien au chaud.
Puisque les journées sont très courtes pendant l'hiver, le cocher ou conducteur attendait généralement les passagers avec des briques bien chaudes et un (ou des) fanal pour éclairer leur chemin s'il faisait nuit et ainsi se rendre à destination en toute sécurité.
Plusieurs se rappellent encore des cortèges lumineux de « cotters » qui défilaient pour se rendre à la messe de minuit.
Les opinions divergent quant à la raison pour laquelle cette expression a pris un sens différent au cours des années. Mais, il est facile de voir pourquoi l'image d'une personne qui en attend une autre, brique et fanal à la main a dû certainement influencer cette perception.
Chose certaine, des nos jours, vaut mieux éviter de se faire attendre avec une brique et un fanal.
Pensée du jour
Mieux vaut se faire dire "Bonne journée" par quelqu'un qui ne le pense pas que se faire envoyer chier par quelqu'un qui le pense.
Inscription à :
Articles (Atom)